Médecins Sans Frontières (MSF) a alerté jeudi sur les « atrocités de masse » et « nettoyages ethniques » en cours dans le Darfour-Nord, où …
MSF alerte sur les « atrocités de masse » en cours au Darfour

Sociologue/ Consultante

Médecins Sans Frontières (MSF) a alerté jeudi sur les « atrocités de masse » et « nettoyages ethniques » en cours dans le Darfour-Nord, où …

Un grand nombre des victimes ont été tuées alors qu’elles se trouvaient devant des sites associés à la Fondation humanitaire de Gaza, conçue par les …
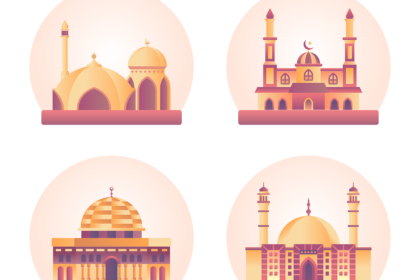
La France ne fait plus partie, ces dernières années, des destinations les plus prisées par les touristes musulmans, comme le confirme le classement 2025 du …

Au moins 65 demandeurs d’aide ont été tués jeudi à Gaza, portant à 550 le nombre de victimes mortes alors qu’elles cherchaient de la nourriture …
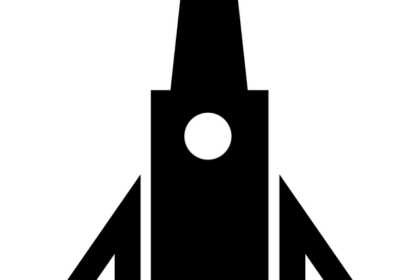
Une attaque a été perpétrée, dimanche 22 juin, dans l’église Saint-Elie, à Damas. L’attentat, commis au cours de la messe du soir avec une ceinture …

Qu’est-il passé par la tête du directeur de l’école Angela Davis à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) ? Celui-ci a publiquement affiché, la veille du 6 juin, …

Depuis le 7 octobre 2023, on dénombre plus de 200 000 morts à Gaza, des civils en majorité dont de nombreux enfants. Mais, tout cela ne suffit pas pour Israël. Gaza est aujourd’hui asphyxiée.