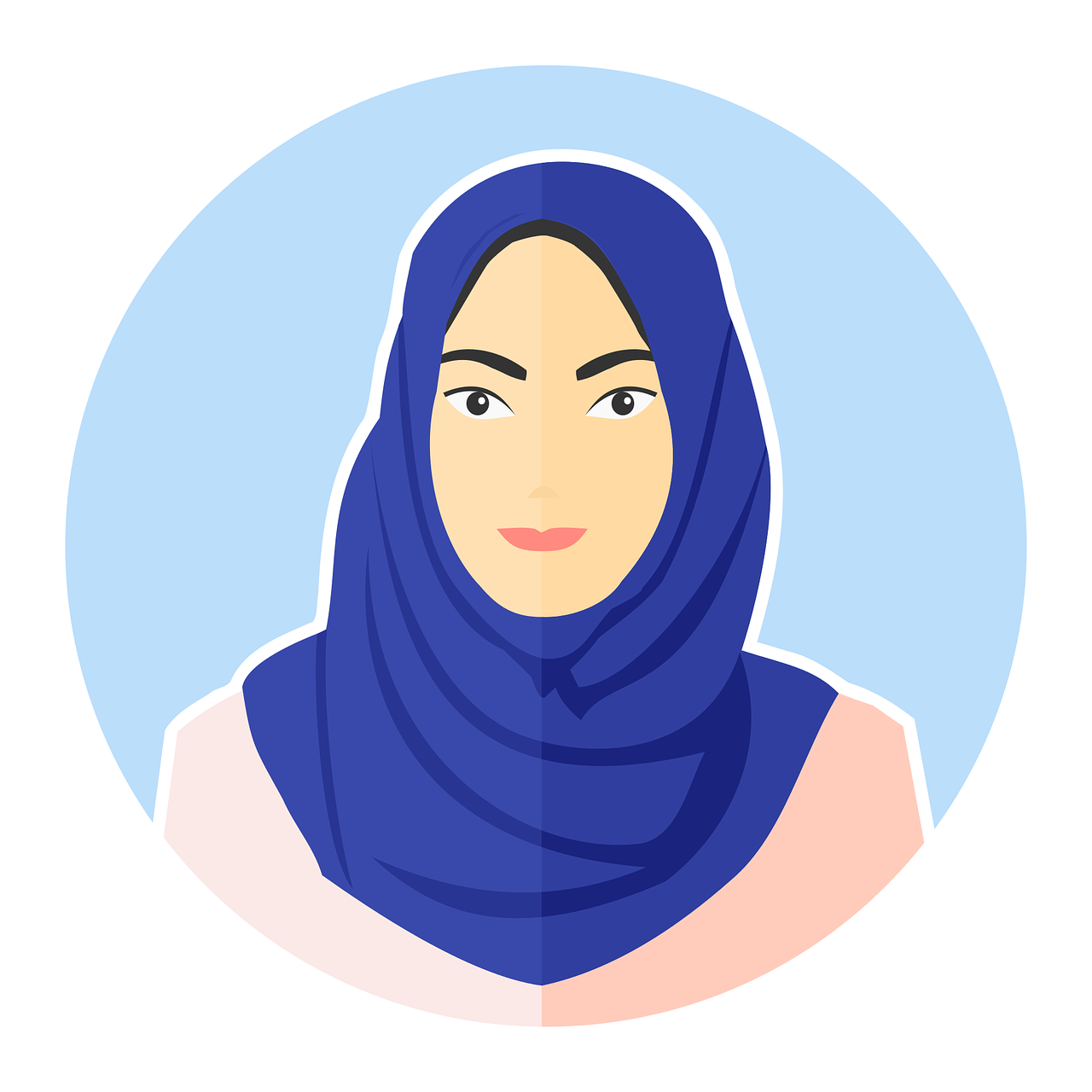La question de l’obligation ou non de porter le voile en islam ne fait pas l’unanimité parmi les musulmans, qui sont nombreux et d’aires géographiques et culturelles très variées et appartiennent de ce fait à différents courants religieux, ou écoles, au sein même de l’islam. Mais il est important tout d’abord de préciser que le voile n’est pas la prérogative des femmes musulmanes. La première loi imposant cet accessoire vestimentaire, nous dit l’historienne de l’art Hana Chidiac, remonte à l’époque mésopotamienne, il y a environ 5 000 ans.
Parmi les facteurs d’incompréhension dont souffre l’islam aujourd’hui, la condition de la femme occupe une place importante, notamment sur la question du voile. Si ce dernier est érigé par certains en symbole de l’asservissement de la femme, ou d’une culture dite rétrograde, c’est entre autres en raison de sa confrontation avec l’Occident, en particulier durant la colonisation, et de son caractère antagonique avec la culture occidentale du corps. En effet, le voile s’oppose de manière radicale au monde occidental de conduite des mœurs et de dressage des corps.
Que le voile soit, par métonymie, une façon de questionner la place de la femme dans la société, nous l’avons bien compris. Mais questionner n’est pas juger, encore moins falsifier. Encourager le communautarisme en prétendant le combattre, c’est là un des fléaux dont il faudrait se débarrasser, mais la réalité est que le repli identitaire induit par des décennies de politiques anti-, antimusulmans, anti-communautariste, a contribué à faire naître une économie communautaire, un islam de marché, avec l’expansion des revendications notamment autour du voile, devenu un phénomène de mode où les jeunes filles l’arborent comme un accessoire identitaire, parfois sans vergogne, sur leurs réseaux sociaux. Le voile renvoie à de multiples significations et reflète des stratégies variées et des formes très différentes (injonction d’un homme, rapport complexe au corps, mimétisme, événement traumatique, post-pèlerinage, etc.). Il s’inscrit bien souvent davantage dans un islam identitaire par lequel on veut se distinguer d’un groupe social, que pour des motivations religieuses.
D’un point de vue religieux et non sociétal, nombre de voix musulmanes et d’islamologues affirment que le voile ne figure pas parmi les commandements du Coran et de la Sunna, et qu’il n’est pas une prescription stricte et précise. Le Coran ne le mentionne que très peu de fois, et, à chaque fois, il s’agit d’un appel à la pudeur et au respect de l’intimité des concerné.e.s, car la pudeur est une exhortation destinée aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Nous observons que le voile résulte d’une interprétation des textes, différente selon les courants doctrinaux, les époques et les lieux, voire du contexte même prêté à son origine. Les islamistes sont souvent accusés, en l’absence d’un projet de société bien défini, d’être obnubilés par la question de la femme et du contrôle de son corps. La condition de la femme musulmane est, il est vrai, déplorable en certains endroits, mais ce n’est pas pour des raisons religieuses. En dépit ici des valeurs dévoyées de l’islam, il est primordial de rappeler que le Coran a donné à la femme un statut lui accordant des droits et dans lequel elle est respectée et honorée, tant sur le plan spirituel que social.
Dans le monde du travail, la question de l’obligation ou non du voile ne se pose pas, c’est une réalité. La présence de salariées voilées questionne les directions d’entreprise en matière de liberté religieuse et peut parfois même les bousculer. L’espace de la symbolique religieuse est le lieu de manifestation d’une psychologie singulière qui entraîne elle-même des conduites spécifiques. Le voile peut ainsi être une source de conflit interne mais aussi externe, pas toujours facile à gérer pour l’organisation. Le porter puis l’enlever en raison de son travail peut également soulever chez certaines femmes des questions d’ordre existentiel aux conséquences fâcheuses pour leur équilibre personnel. En effet, là se pose la question de l’acceptabilité d’une loi, entre protection de tous et ingérence pour une partie. Si dans l’esprit, nous pouvons en comprendre la raison, dans les faits, les conséquences sont contre-productives puisqu’elles contribuent à altérer l’identité de ces femmes et de leur « être au monde », tout en ébranlant leur foi et générant, pour les plus fragiles, des troubles mentaux tels la manie ou la dépression, quand ce n’est pas du radicalisme. Au cours de ce cheminement tortueux, l’imam de la mosquée ou sur Internet reste l’interlocuteur privilégié, qui n’a pas forcément les réponses adaptées dans pareille situation. Nous observons que tant qu’il y aura des diversités de cultures et d’interactions, le (faux) débat sur le voile ne cessera d’exister de manière tout à fait légitime, même si nous remarquons qu’en France ce symbole, minoritaire parmi les musulmanes, nourrit fréquemment de vives polémiques. Le temps est venu de laisser aux uns la capacité d’organiser, d’éduquer et d’instruire leur communauté, et aux autres de véhiculer bienveillance et respect, en pariant sur la cohésion nationale et non sur la division.